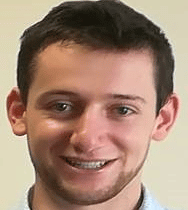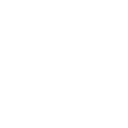Accueil > Et si 2025 était l’année des SCOP ? > Et si 2025 était l’année des SCOP ?

5 min.
ESS
Et si 2025 était l’année des SCOP ?
Date de publication : 04/03/2025

Gilles Larvaron
En un sens, oui, 2025 sera l’année des coopératives. Organisée par l’ONU dans le cadre d’une résolution votée en juin 2024 sur une proposition du Kenya et de la Mongolie, l’année 2025 a été décrétée année des coopératives dans le monde avec un mot d’ordre, « Les Coopératives construisent un monde meilleur ». Cette initiative est aussi un prolongement de la première année des coopératives qui avait été décidée en 2012.
2025 pourrait aussi être l’année des SCOP à l’aulne des résultats économiques de l’année 2024. Par une étude approfondie de cette année de crise économique, d’inflation galopante et de conflits internationaux dramatiques, des éléments saillants sur la résilience des modèles coopératifs émergent. Nous y reviendrons tout au long de cet article.
Avant de se plonger dans les chiffres et la réalité de l’activité des SCOP en France, revenons sur leur origine.
Des associations ouvrières aux sociétés coopératives
D’où vient ce mouvement coopératif ?
L’origine du statut coopératif est intimement liée à l’évolution du droit d’association qui a connu quelques soubresauts tout au long du XIX° siècle. Pendant que les régimes politiques de nature bien différente se succédaient, la France est percutée économiquement par l’avènement de l’ère industrielle déclenchant 2 phénomènes massifs, l’exode rurale et l’apparition d’une classe ouvrière de masse pour alimenter les grandes chaînes de montage. Ces « nouveaux » travailleurs vont alors essayer de se constituer en association pour faire exister leurs droits. Interdites en 1791 par la loi Le Chapelier contre les corporations, autorisées en 1848 puis à nouveau interdites la même année, ré-autorisées en 1864 par la loi Ollivier, elles vont connaître un tournant décisif, prémices de la société coopérative, lors des événements de la Commune de Paris en 1871. Les chefs d’entreprises ayant abandonné les ateliers, les ouvriers s’organisent pour les reprendre et les rouvrir.
Le statut coopératif est définitivement reconnu en 1884 avec la création de la Chambre consultative des associations ouvrières de production, et se démarque de l’histoire des associations et des syndicats en incluant d’emblée une perspective de production et de création associant directement les ouvriers. L’Alliance Coopérative Internationale est créée dans la foulée, en 1892. Dans le même temps, était votée la loi légalisant les syndicats professionnels ouvriers et patronaux, la loi “Waldeck-Rousseau”.
Il faut attendre 1947 pour qu’un cadre juridique soit posé sur l’activité coopérative (toujours en vigueur aujourd’hui) mais il faut attendre les années 70 et 80 pour assister au développement décisif des sociétés coopératives. En France, elles sont environ 250 au début du XX° siècle, elles sont 650 en 1979 puis 1300 en 1983, employant près de 40.000 personnes (en savoir plus)
En 1995 et en 2001 deux déclinaisons des SCOP sont créés, les CAE – Coopératives d’activité et d’emploi – et les SCIC – Sociétés Coopératives d’intérêt collectif, permises par la loi sur la modernisation du statut des coopératives en 1992.
Enfin, la loi sur l’ESS dite loi « Hamon » de 2014 instaure de nouvelles dispositions en faveur du développement du modèle coopératif :
- Création du statut de Scop d’amorçage,
- Création des groupements de Scop
- Développement de l’ancrage territorial des Scic avec l’augmentation du capital pouvant être détenu par les collectivités (50 %)
Les Sociétés Coopératives : définition
Mais qu’est-ce qu’une SCOP ?
Au sens strict du droit, c’est une société commerciale dans laquelle la majorité du capital et du pouvoir de décision sont détenus par les salariés et dont le fonctionnement sur 7 principes issus de la déclaration sur l’identité coopérative :
- Adhésion volontaire et ouverte à toutes et tous
- Pouvoir démocratique exercé par les membres
- Participation économique des membres
- Autonomie et indépendance
- Éducation, formation et information
- Coopération entre les coopératives
- Engagement envers la communauté
A cela, s’ajoute donc 2 statuts spécifiques :
- La CAE : les membres ont le statut d’entrepreneurs-salariés et sont accompagnés grâce à des services et outils mutualisés même s’ils n’ont pas tous la même activité
- La SCIC qui répond à 2 critères spécifiques :
- Assurer la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale
- Justifier son intérêt collectif par un projet de territoire ou de filière d’activité impliquant un sociétariat hétérogène (multisociétariat), le respect des règles coopératives (1 personne = 1 voix), et la lucrativité limitée (obligation de réinvestir dans l’activité la quasi-totalité des excédents)

Les coopératives dont les associés sont des entreprises ou des entrepreneurs que l’on retrouve généralement dans le secteur agricole
Les coopératives d’usagers que l’on retrouve dans le secteur des HLM par exemple ou encore dans l’éducation (coopérative scolaire)
Les sociétés coopératives de production qui sont celles que nous évoquons tout au long de cet article et qui rentrent dans le cadre de la loi ESS de 2014.
Petit panorama des SCOP en 2024 en France
Le portrait-robot d’une SCOP
En 2024, il y avait 4.140 SCOP et 1.417 SCIC en France totalisant un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’€ et 88.000 emplois. Il y a une moyenne de 21 salariés par SCOP pour un chiffre d’affaires moyen de 1,8 millions d’€. Elles sont majoritairement basées dans l’ouest de la France, de l’Ile de France jusqu’à la Bretagne en passant par le Centre Val de Loire.
40% de ces sociétés coopératives sont le prolongement d’une activité existante (16% d’entre elles sont le fruit d’une transformation d’activité venant du secteur associatif, 16% proviennent d’une transmission d’entreprise saine et 8% sont le résultat d’une reprise d’entreprise en difficulté) et 60% ont été entièrement créées ce qui est un changement important car jusqu’à présent, la dynamique était inversée (selon le rapport d’activité des SCOP)
Et pourquoi ce modèle coopératif fait ses preuves en 2024 ?
L’année 2024 aura été une année difficile pour l’économie française, et plus largement pour l’économie européenne et mondiale. Guerres commerciales et guerres réelles aux portes de l’Europe, inflation, sortie des dispositifs « COVID », instabilité politique, les causes sont multiples mais elles frappent durement les TPE et PME françaises qui se retrouvent dans une situation de fragilité plus importante que pendant le COVID[1]. Mais pour contrer cette morosité ambiante, les sociétés coopératives sont en train de confirmer leur capacité de résilience, de résistance et de solidité en période de crise, comme cela avait déjà été entraperçu lors de la crise du COVID[2].
Voici les quelques chiffres qui démontrent la force du modèle coopératif en période de crise issus du rapport d’activité des Scop :
- Taux de pérennité à 5 ans : 79%
- Les entreprises classiques ont un taux à 61% pour la même période
- Ce taux est de 76% quand la société coopérative est le fruit d’une reprise d’une entreprise en difficulté. L’exemple le plus symbolique étant la reprise de Duralex par ses salariés (en savoir plus).
- Croissance du chiffre d’affaires du secteur en 2024 : 6% alors que La France a connu une croissance de 1,1% en 2024
- Croissance de l’emploi dans le secteur en 2024 : +4% alors que l’emploi en France a stagné sur la même période.
[1] https://www.insee.fr/fr/statistiques/8316145#
[2] https://theconversation.com/les-cooperatives-traversent-mieux-les-crises-que-les-entreprises-classiques-247921
Quelles seraient les raisons de cette capacité d’adaptation aux crises économiques ?
L’agilité : les sociétés coopératives sont des structures souples qui s’adaptent rapidement à leur contexte. Cette adaptabilité est rendue possible par le fait que les salariés sont associés à la gouvernance de ces sociétés, favorisant des échanges et des décisions adaptés en temps réelle à la situation de chacune et chacun.
Leur lien avec l’économie locale : souvent implantées sur des écosystèmes locaux, cela les rend plus imperméables aux crises économiques internationales souvent issues de crises financières.
L’importance moindre donnée à la rentabilité économique : tout est fait dans le modèle coopératif pour ne pas dépendre seulement de la seule rentabilité économique. Son utilité sociale, son impact environnemental sont aussi considérés comme des valeurs ce qui permet à ces sociétés de mesurer la portée de leurs services et ou de leurs produits au-delà de toute notion de rentabilité nette.
Alors, pourquoi ne pas profiter de cette année 2025 dédiée au modèle coopératif pour vous renseigner et participer aux événements organisés partout en France : https://2025.coop/ ?
Pour aller plus loin
 L’Economie Sociale et Solidaire : Entreprendre autrement
L’Economie Sociale et Solidaire : Entreprendre autrementAuteur(s) :

Gilles Larvaron
Coordinateur national Économie Sociale