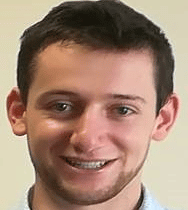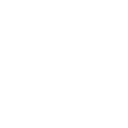Accueil > La transparence des associations en termes de « durabilité » > La transparence des associations en termes de « durabilité »

7 min.
ESS
La transparence des associations en termes de « durabilité »
Date de publication : 20/02/2025

Laurent Simo
Une actualité ébranle le monde des sociétés, celle de devoir établir un rapport de durabilité annuel en complément des états financiers. Ceci va s’appliquer progressivement pour les plus grandes sociétés entre 2025 et 2027.
Pourquoi les sociétés en sont-elles effrayées ? On peut bien entendu imaginer qu’elles ne souhaitent pas dévoiler des informations sur leur nuisance sur l’environnement ou bien une inégalité de traitement envers ses salariés, mais c’est surtout la lourdeur de l’ensemble des sujets prévus qui pose question.
Les entités du monde non lucratif, tels que les associations, ne seront pas, en tout cas ce n’est pas prévu pour l’instant, soumises à cette obligation de publication.
Pourtant, établir des indicateurs en termes de durabilité présente également un enjeu crucial pour ce secteur qui, de manière fréquente, a déjà mis en place des mesures d’impact. Nous vous indiquerons dans cet article les principales raisons pour mettre en œuvre, de manière volontaire, des indicateurs de durabilité.
Les obligations règlementaires
La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) est une directive européenne publiée le 16 décembre 2022 imposant une norme sur les rapports de développement durable [1] des entreprises. Elle vise à harmoniser le reporting d’informations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Elle est directement issue des accords de Paris de 2015 prévoyant notamment de contenir le réchauffement climatique en deçà de 2°c (et si possible 1,5°c) d’ici 2100 avec un objectif ambitieux d’atteindre une neutralité climatique d’ici 2050, mais aussi du pacte vert européen (Green Deal) engageant l’Union Européenne par diverses mesures sur la voie de la transition écologique.
Transposée en France en décembre 2023, cette directive s’impose aux sociétés commerciales, aux établissements de crédits et aux entités exerçant des activités d’assurance, mutualiste, de prévoyance ou de protection sociale dépassant certains seuils. Dès 2025, des sociétés de taille intermédiaire seront concernées, notamment celles dépassant 2 des 3 seuils suivants : chiffre d’affaires > 50 M€, total bilan > 25 M€, 250 salariés. Quelles que soient leur taille, les associations ne sont pas contraintes à publier ce reporting extra financier.
[1] Soit un « développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable » – notion définie lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, sous l’égide des Nations Unies
Quel type d’informations ?
La directive impose un cadre très défini sous forme d’un rapport d’indicateurs en matière environnemental, sociétal et de gouvernance devant figurer dans une section « état de durabilité » de leur rapport de gestion annuel.
Pour établir ce rapport, les entreprises concernées sont dans l’obligation de respecter les normes dites ESRS (European Sustainability Reporting Standards) qui définissent de manière précise les informations à publier en matière de durabilité. Il existe une base commune mais également des compléments pour les établissements financiers et d’autres qui seront promulguées par secteur d’activité (ESRS sectorielles).
Le cadre normalisé du reporting
Le rapport attendu en termes d’informations de durabilité se décline à travers 12 normes.
Un premier cadre (ESRS1) se présente sous la forme d’une norme transverse définissant 4 piliers, permettant de déterminer comment l’entité intègre les enjeux de durabilité dans son fonctionnement en termes de :
- Gouvernance
- Stratégie
- Gestion des impacts, risques et opportunités (IRO)
- Indicateurs et cibles
Il s’agit en fait d’exigences générales qui seront à décliner à l’intérieur de chacune des normes définies dans le cadre normalisé du rapport
Une seconde section (ESRS 2) détaille les informations générales afin de positionner l’entité vis-à-vis des exigences de publication : périmètre de la société ou du groupe, sa politique générale en matière de durabilité, la méthodologie qu’elle a appliquée et de manière globale tous les points essentiels permettant de justifier les raisons pour lesquels elle ne publie pas d’indicateurs sur l’ensemble des sujets prévus.
La suite est consacrée à l‘ensemble des normes (10 au total) sur lesquelles l’entité devra matérialiser son positionnement :
Informations environnementales :
- Changement climatique (ESRS E1)
- Pollution (ESRS E2)
- Ressources marines et en eau (ESRS E3)
- Biodiversité et écosystèmes (ESRS E4)
- Utilisation des ressources et économie circulaire (ESRS E5)
Informations sociales :
- Main d’œuvre de l’entreprise (ESRS S1)
- Employés de la chaîne de valeur (ESRS S2)
- Communautés concernées (ESRS S3)
- Consommateurs et utilisations (ESRS E4)
Informations de gouvernance :
- Conduite commerciale (ESRS G1)
Chacune de ces normes regroupe des exigences de publication (disclosure requirements) au nombre de 82 : pour chacune de ces exigences (à l’exception de celle sur le changement climatique, jugée a priori comme concernant toutes les entités), l’entité devra déterminer si elle doit ou non établir des informations selon l’analyse de la double matérialité.
Cette méthodologie implique d’une part d’évaluer l’incidence de l’entité sur l’exigence concernée (la matérialité d’impact) et d’autre part l’incidence de l’exigence concernée sur l’entité (la matérialité financière). Ainsi, dès lors que l’entité estime que le thème est matériel, c’est à dire ayant un impact significatif, une information sera attendue en déclinant celle-ci par le biais de points de données (data points).

Pour aller plus loin :
 Le tableau de bord, un outil de pilotage nécessaire pour contrôler la stratégie de l’association
Le tableau de bord, un outil de pilotage nécessaire pour contrôler la stratégie de l’associationUn enjeu au cœur des préoccupations
La plupart des grandes entreprises vont devoir développer des compétences propres ou s’attacher de prestataires externes pour définir, quantifier, évaluer et rendre compte de ces indicateurs pour les prochaines années. En outre, les informations devront être publiées annuellement, ce qui signifie que les indicateurs devront être suivis dans le temps : des comités spécifiques devront être créés et des positionnements forts devront être pris par les organes de gouvernance.
Les points de difficulté sont nombreux et se posent sur la capacité à évaluer certains critères qui peuvent être qualitatifs, et dont l’évaluation quantitative peut s’avérer complexe à réaliser, sachant que ceux-ci doivent également intégrer la « chaîne de valeur ».
En effet, ce rapport de durabilité doit également inclure les impacts des activités de la chaîne « amont » (fournisseurs, sous-traitants, etc.) ainsi que celle de la chaîne « aval » (clients, distributeurs, usagers, etc.) permettant d’estimer les effets sur chaque critère des produits vendus et des prestations délivrées par l’entité jusqu’à leur fin de vie.
Il s’agit ainsi d’un nombre significatif d’acteurs qui sont concernés par cette norme de publication. L’effet induit est que les entités soumises à cette obligation vont également solliciter des informations en matière ESG auprès de leurs parties liées.
Ainsi, même les plus petites sociétés, ou les acteurs associatifs, devront être en mesure de fournir des indicateurs pour les structures les plus importantes avec lesquelles elles ont contractualisé des relations d’affaires.
Ceci va chambouler le paysage en termes d’informations extra financières à produire. De nombreuses demandes sont d’ailleurs déjà en cours pour réclamer un décalage de la mise en application ou une simplification du nombre de critères obligatoires.
Un point extrêmement important est également à retenir : les informations de ce rapport devront faire l’objet de vérifications par un auditeur de durabilité, soit un commissaire aux comptes ayant acquis son visa de « durabilité » soit par un organisme tiers indépendant habilité. Il devra ainsi garantir la qualité et la fiabilité de la méthodologie retenue et des indicateurs publiés.
Cet article pourrait vous plaire :
 Responsabilité sociétale des organisations
Responsabilité sociétale des organisationsUne publication volontaire ?
Comme précisé ci-avant, les entités qui n’ont pas le statut de sociétés ne seront pas concernées : ainsi, les associations et fondations ne sont pas incluses dans le périmètre d’obligation. Ce peut être cependant le cas pour d’autres structures de l’économie sociale et solidaire comme les sociétés coopératives.
Toutefois, les associations peuvent être concernées à double titre :
- Soit parce qu’elles feront partie des entités qui devront fournir des indicateurs auprès des sociétés concernées par les obligations de publication, et avec lesquelles elles ont des relations d’affaires,
- Soit parce que la nature de leurs activités et/ou leur mode de financement implique que des informations en matière de durabilité s’avèrent nécessaires bien que celles-ci demeurent dans un cadre volontaire.
En effet, plusieurs éléments viennent renforcer cette nécessité.
De nombreux acteurs développent déjà des projets en matière de préservation de l’environnement, d’assistance aux personnes les plus démunies ou en situation de précarité, de recyclage, etc. Il pourrait ainsi apparaître paradoxal de mettre en œuvre des actions de ce type sans pour autant déterminer en quoi l’entité elle-même peut générer des impacts négatifs, notamment en termes d’environnement.
Par ailleurs, le mode de financement des acteurs associatifs, largement dominé par les ressources en subventions, de dons de particuliers ou de mécénats d’entreprises, renforce l’obligation de transparence au-delà du strict aspect financier. Ainsi, il semble évident que ces principaux financeurs souhaiteraient obtenir des informations sur les impacts des structures soutenues en termes environnemental et sociétal, ainsi que sur la qualité de leur mode de gouvernance. Cette tendance n’aura que vocation à s’accentuer et on peut ainsi imaginer que des appels à manifestations d’intérêt de la part des collectivités ou des appels d’offres incorporeront des critères de sélection strictes en fonction d’indicateurs de durabilité.
L’avantage réside dans le fait que les associations pourront échapper au cadre règlementaire et ainsi choisir les thématiques et indicateurs qui leur semblent les plus adaptés. Cependant, afin de démontrer leurs impacts en toute sincérité, il sera recommandé de suivre les principaux cadres du rapport de durabilité normalisé, aussi bien dans sa trame que par ses différents points de données.
Au final, la démarche pourra s’avérer proche de celle que doivent mettre en œuvre les sociétés en définissant tout d’abord le périmètre pris en compte, la stratégie définie en matière de durabilité et décliner ensuite les indicateurs clés sur les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les méthodes à retenir seront celles préconisées par la CSRD tel que la prise en compte des impacts, risques et opportunités (IRO) pour chaque facteur, c’est-à-dire sans oublier les risques potentiels auxquels l’entité sera soumise dans les prochaines années mais également les opportunités que l’évolution de la société pourra lui ouvrir.
Pour aller plus loin :
 Entreprise à impact : de quoi parle-t-on ?
Entreprise à impact : de quoi parle-t-on ?La tenue d’engagements
Au niveau européen, la publication de la CSRD n’est qu’une première étape : en effet, si celle-ci rend obligatoire un reporting de durabilité pour les plus grandes sociétés, elle ne rend pas nécessaire la tenue d’engagements. C’est une nouvelle directive, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) qui définira à terme le comportement à adopter visant à garantir que le modèle de l’entité et sa stratégie sont compatibles avec la transition vers une économie durable et limitant le réchauffement climatique.
Cette obligation d’agir s’accompagnera d’un devoir de vigilance et de la mise en place de diligences raisonnables pour identifier, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités sur leur environnement et les populations.
Nos conseils
Même non concernées par des aspects règlementaires, toutes les entités autre que les sociétés devront s’intéresser à cette problématique de rapport de durabilité, soit parce qu’elles auront besoin de fournir des indicateurs à leurs relations d’affaires, soit par ce qu’elles auront décidé que ce type d’informations ne pourra que valoriser leur mode de fonctionnement.
Ainsi, s’approprier cette démarche sera essentielle pour s’inscrire dans la pérennité :
- Accompagner la transformation des modèles d’affaires pour renforcer la résilience et réduire la dépendance aux ressources rares ;
- Anticiper les évolutions réglementaires et s’aligner avec les demandes des parties prenantes ;
- Améliorer sa réputation et attirer de nouveaux talents ;
- Faciliter l’obtention de financements et son attractivité.
Ainsi, chaque entité aura intérêt à s’engager sur le chemin de la publication volontaire d’indicateurs de durabilité et une stratégie globale devra être définie. Des personnes clés devront être sélectionnées et dans tous les cas, un accompagnement externe sera nécessaire.
Auteur(s) :

Laurent Simo
Expert-comptable, commissaire aux comptes, associé, directeur national ESS, auditeur de durabilité
Laurent est associé au sein du cabinet In Extenso. Expert-comptable et commissaire aux comptes spécialiste du secteur associatif et ESS, il est en charge du Marché Economie Sociale du groupe In Extenso.