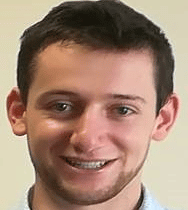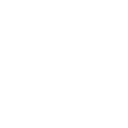Accueil > La gestion quotidienne des administrateurs et bénévoles dans les associations > La gestion quotidienne des administrateurs et bénévoles dans les associations

9 min.
Gestion
La gestion quotidienne des administrateurs et bénévoles dans les associations
Date de publication : 06/11/2025

Philippe Guay
Après avoir consacré un article sur le recrutement des administrateurs et bénévoles au sein de l’association, il convient désormais de se pencher sur le statut particulier à leur appliquer et les règles à respecter pour assurer le bon fonctionnement et les bonnes relations avec ces acteurs et animateurs de la vie de votre organisme.
Les liens réglementaires entre l’association et ses administrateurs : recommandations et bonnes pratiques
Les fonctions et rôles confiés aux administrateurs sont bien souvent abordés dans les statuts de l’association. Avec plus ou moins de précisions selon le choix retenu par les fondateurs. Lorsque cela s’avère nécessaire, les règles de vie et de fonctionnement du conseil d’administration sont complétées par des résolutions soumises à l’approbation des administrateurs. Elles peuvent également être consignées au sein d’un règlement intérieur du conseil d’administration. Ces prises de décisions, ou mises à jour du règlement intérieur du conseil d’administration, se passent bien souvent lors de la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante.
A cette occasion, il est important de préciser :
- Les modalités de fonctionnement collectives et relationnelles des administrateurs entre eux et vis-à-vis de l’association ;
- La mise en place de différentes commissions et sous-commissions, si nécessaire, et selon les besoins de l’organisme ;
- Les règles hiérarchiques qu’il convient de respecter pour assurer le bon fonctionnement de la gouvernance ;
- Les délégations de pouvoir et règles de confidentialité ;
- Les modalités de prise en charges de frais engagés par les administrateurs dans le cadre de leurs fonctions.
La charte de l’administrateur
Tous ces sujets, et d’autres plus particuliers à l’activité spécifique de l’association ou à son secteur, peuvent être regroupés dans un document unique organisé qui peut constituer une « charte de l’administrateur ». L’intérêt d’un tel document est son caractère pérenne. Il centralise tous les sujets propres à la fonction d’administrateur, il peut être mis à jour régulièrement et il est transmissible aux nouveaux élus qui rejoignent le cercle des dirigeants de l’association.

Sur le plan règlementaire, on relèvera que, la plupart du temps, les administrateurs exercent leur fonction de manière bénévole et nous soulignerons, ici, que l’absence de contrepartie financière est une caractéristique fréquente relative à la fonction d’administrateur. D’ailleurs, l’administration fiscale, hormis quelques cas particuliers de tolérance qui ne seront pas développés ici, s’appuie sur les fondamentaux de la loi du 1er juillet 1901 et apprécie la pratique de rémunération des dirigeants de l’association pour considérer le statut fiscal de celle-ci et son assujettissement ou non aux impôts commerciaux.
Précautions et sauvegarde des responsabilités avec les bénévoles
Tout comme pour les administrateurs, les fonctions du bénévole de l’association se caractérisent par une mise à disposition gracieuse de son temps au service de l’organisme.
- Les dirigeants de l’association (membres du conseil d’administration ou délégués à certaines commissions), d’une part;
- Les salariés (lorsque c’est le cas), d’autre part.
Dans un cas comme dans l’autre, le bénévole doit s’insérer sereinement dans l’organisation de l’association. Il doit savoir à qui il doit se référer et partager ses actions, besoins et difficultés éventuelles. Une description claire de la hiérarchie en place doit permettre d’éviter les conflits.
Dans certaines structures où l’appel aux bénévoles est important et structuré, un organigramme hiérarchique propre aux fonctions et équipes de bénévoles peut être mis en place. Dans ce cas, les relations avec les dirigeants élus ou salariés de l’association doivent être clairement identifiées et connues de tous.
Le bénévole ne perçoit aucune rémunération
Comme pour les administrateurs, le bénévole ne doit percevoir aucune rémunération pour la fonction qu’il occupe, ni en espèces, ni sous la forme d’avantages en nature. Il convient d’être attentif à cette caractéristique car les jurisprudences sont nombreuses qui remettent en cause la situation de bénévoles pour lesquels l’administration estime que les avantages en nature (logement, repas, par exemple) perçus dans un contexte de lien de subordination constituent des rémunérations soumises à cotisations sociales.
Cette nuance est parfois difficile à démontrer, surtout lorsque le bénévole participe activement aux activités développées par l’association aux cotés de collaborateurs salariés. Dès lors que l’activité du « bénévole » est requalifiée en activité salariée, l’ensemble de la réglementation du travail et de la protection sociale s’applique. Ainsi, notamment, l’association doit procéder à l’affiliation de l’intéressé au régime général de sécurité sociale, payer les cotisations dues au titre des rémunérations ou des avantages en nature versés et appliquer les règles prévues en matière d’accidents du travail. Par ailleurs, le défaut de déclaration préalable à l’embauche découlant de l’emploi d’un « faux bénévole » ainsi que celui du non-établissement des déclarations sociales et du bulletin de paie sont constitutifs de l’infraction de travail dissimulé.
Les frais engagés par les bénévoles
Les bénévoles peuvent être amenés à engager, à titre personnel, des dépenses pour le compte de l’association (déplacements, achats de matériel, hébergement, etc.).
Ces frais peuvent faire l’objet soit d’un remboursement par l’association, soit d’un abandon volontaire par le bénévole, pouvant alors donner lieu à une réduction d’impôt si certaines conditions sont réunies. Le régime applicable à ces frais est encadré par la doctrine fiscale, la jurisprudence et le Code général des impôts (CGI).
Pour aller plus loin
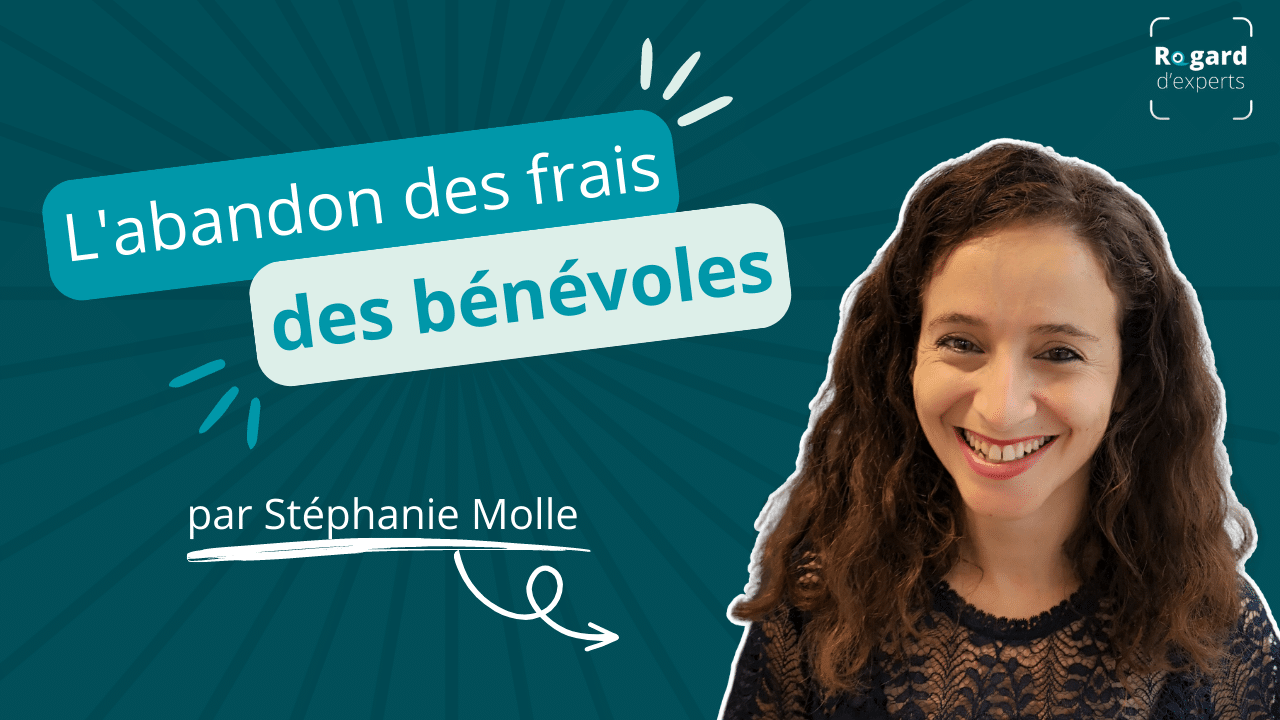 L’abandon de frais par les bénévoles
L’abandon de frais par les bénévolesRemboursement des frais engagés par les bénévoles
L’article 200 du CGI permet à un bénévole de renoncer au remboursement de ses frais, à condition que ceux-ci soient réels, justifiés, et liés directement à l’activité associative.
a. Conditions générales du remboursement.
Pour qu’un remboursement soit effectué par l’association :
- Les frais doivent être engagés dans le cadre de l’activité bénévole.
- Ils doivent être justifiés par des pièces comptables (factures, tickets, notes de frais).
- Ils doivent correspondre à des dépenses réelles et non forfaitaires (sauf pour les indemnités kilométriques pour lesquelles cependant les trajets doivent être détaillés).
- Ils doivent être enregistrés dans la comptabilité de l’association.
b. Types de frais concernés.
Parmi les dépenses remboursables :
- Frais de déplacement (train, transports en commun, véhicule personnel) ;
- Frais de repas ;
- Frais de logement ;
- Achats de fournitures ou de petit matériel liés à la mission confiée au bénévole.
c. Barème kilométrique
Pour l’usage d’un véhicule personnel, il conviendra d’appliquer le barème kilométrique des salariés ou des travailleurs indépendants.
Abandon de remboursement des frais et réduction d’impôt
a. Principe
Le bénévole peut renoncer au remboursement de ses frais réels engagés pour le compte d’une association. Cette renonciation est alors assimilée à un don, ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu.
b. Conditions à remplir
Pour bénéficier de la réduction d’impôt :
- L’association doit être éligible au régime fiscal du mécénat tel que prévu à l’article 200 du CGI (activités d’intérêt général, but non lucratif, gestion désintéressée).
- Les frais doivent être :
- Engagés dans le cadre d’une mission bénévole ;
- Justifiés par des pièces probantes (notes de frais, justificatifs de déplacement, factures) ;
- Le bénévole doit formellement renoncer au remboursement (lettre de renonciation datée et signée).
- L’association doit remettre un reçu fiscal au bénévole.
c. Taux et plafonds
Le bénévole peut alors bénéficier :
- d’une réduction d’impôt de 66 % du montant des frais abandonnés (dans la limite de 20 % du revenu imposable) ;
- ou 75 % si l’association est reconnue d’aide aux personnes en difficulté (plafond de 1 000 € en 2025, avant retour au plafond classique).
Traitement comptable et obligations de l’association
L’association doit :
- Tenir une comptabilité rigoureuse des frais engagés, qu’ils soient remboursés ou abandonnés ;
- Conserver les justificatifs pendant 6 ans minimum ;
- Être en mesure de produire, en cas de contrôle, les lettres de renonciation et les notes de frais ;
- Veiller à ce que les reçus fiscaux soient délivrés uniquement si toutes les conditions sont réunies.
La délivrance abusive de reçus fiscaux peut entraîner des sanctions fiscales et la remise en cause du régime fiscal général de l’association.
Jurisprudence et doctrine administrative
- CE, 30 octobre 2009, n° 308312 : confirme qu’un abandon de frais dûment justifié et formalisé peut être assimilé à un don éligible à la réduction d’impôt.
- BOI-IR-RICI-250-10-10 (Bulletin Officiel des Finances Publiques) : précise les modalités de justification et les obligations documentaires liées aux frais engagés par les bénévoles.
Quelques bonnes pratiques que nous recommandons
- Utiliser un modèle de note de frais standardisé ;
- Exiger des justificatifs originaux ;
- Conserver une lettre de renonciation datée pour chaque période (généralement annuelle) ;
- Mettre à jour le barème kilométrique chaque année ;
- Former les bénévoles à la procédure.

Le contrat d’engagement bénévole
Pour parfaire la relation avec chaque bénévole, nous vous recommandons d’établir un contrat d’engagement bénévole avec chacun de vos bénévoles et pour chaque circonstance ou évènement particulier. Ce contrat aura un caractère permanent ou délimité dans le temps lorsque, par exemple, appliqué à un évènement ou une manifestation particulière.
Différents modèles de conventions d’engagement bénévole existent comme le « passeport bénévole » instauré par France bénévolat qui constitue un véritable outil de dialogue entre l’association et le bénévole.
Cette démarche permet aux associations de les aider dans leur rôle de gestion des ressources humaines que constituent le bénévolat associatif. Le document aborde différents axes tels que :
- Définir la mission, en précisant le rôle, les responsabilités et la place du bénévole dans l’objet de l’association et son projet ;
- Être à l’écoute pour mieux connaître les aspirations des bénévoles et s’interroger ensemble sur les évolutions possibles ;
- Suivre leurs parcours ;
- Créer un temps d’échange et faire un bilan pour apprécier les actions des bénévoles et fixer de nouveaux objectifs en expliquant leur sens.
La démarche permet de faire le point plus facilement sur la participation du bénévole à l’activité de l’association. Répertorier les actions et les fixer par écrit en remplissant le contrat d’engagement bénévole est une manière de respecter le travail effectué et de montrer de la reconnaissance à ses bénévoles.
Ainsi, le sens de la mission du bénévole par rapport au projet de l’association apparaît clairement. Ce temps d’échange est aussi l’occasion de s’intéresser à la motivation des bénévoles, leurs idées, et reconnaître le bénévole dans sa dimension humaine. C’est également le bon moment pour rappeler la place et le rôle du bénévole dans le projet associatif et notamment d’aborder une question sensible : l’équilibre entre liberté d’action du bénévole et cohérence du projet collectif.
Les garanties en matière d’assurance des bénévoles
En dehors de certains secteurs à caractère social, l’activité des bénévoles n’est, en principe, pas couverte par une garantie relative à une assurance « accident du travail ». Il est donc vivement conseillé aux associations de contracter une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques encourus par les bénévoles. Dans ce cas, généralement, les accidents couverts sont exclusivement ceux survenus par le fait ou à l’occasion des fonctions bénévoles considérées et incluent les accidents de trajet.
En savoir plus
 La responsabilité civile des associations
La responsabilité civile des associations
Le Code de la Sécurité Sociale permet aux organismes d’intérêt général qui le souhaitent de souscrire une assurance collective couvrant les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles de leurs bénévoles (CSS art. L 743-2). Sont concernés les organismes d’intérêt général entrant dans le champ d’application de l’article 200 du CGI, c’est-à-dire ceux ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Retour sur la situation du bénévole mineur en France : quelles sont les règles ?
Dans un précédent article, nous avons évoqué la place particulière que les bénévoles mineurs peuvent tenir au sein de l’association. Lorsque des mineurs souhaitent s’engager dans une association, l’organisation doit respecter certaines obligations pour garantir leur sécurité et leur bien-être. L’association doit veiller à ce que les mineurs soient correctement encadrés. Les activités proposées doivent être adaptées à leur âge et à leur niveau de maturité.
Il convient également de veiller à l’encadrement par des adultes responsables, formés et expérimentés. Les associations qui accueillent des bénévoles mineurs doivent s’assurer que ces derniers bénéficient d’une couverture d’assurance adéquate. Cela inclut une assurance responsabilité civile et une couverture des risques liés aux activités qu’ils pratiquent. L’association doit veiller à ce que les activités proposées ne présentent pas de risques démesurés pour la sécurité des mineurs. Par exemple, un mineur ne pourra pas être sollicité pour des activités dangereuses sans avoir d’abord reçu une formation spécifique ou une autorisation. L’association doit également veiller à leur fournir des équipements adaptés (vêtements de sécurité, protections, etc.).
En tant que mineurs, les bénévoles doivent bénéficier d’une protection renforcée en ce qui concerne la collecte de leurs données personnelles et l’usage qui en est fait. L’association doit être particulièrement vigilante à respecter la législation sur la protection des données personnelles (RGPD).
Les mineurs peuvent participer à une variété d’activités au sein des associations, mais certaines doivent être adaptées en fonction de leur âge et de leur développement. Voici quelques exemples d’activités généralement accessibles aux mineurs :
- Activités de sensibilisation et de communication : Les mineurs peuvent être impliqués dans des projets de sensibilisation, des actions de collecte de fonds ou des événements de promotion de l’association, comme des stands lors de salons ou de festivals. Ces activités sont souvent peu risquées et peuvent être adaptées à leur âge.
- Bénévolat dans le secteur social : Les mineurs peuvent également participer à des actions bénévoles dans le cadre d’associations de solidarité, en s’impliquant dans l’accompagnement d’enfants, de personnes âgées, ou en participant à des collectes de vêtements ou de nourriture. Ces activités doivent rester dans un cadre supervisé.
- Activités de loisirs et de culture : Les associations sportives, culturelles ou artistiques accueillent fréquemment des bénévoles mineurs. Les jeunes peuvent ainsi aider dans l’organisation d’événements ou participer à des activités éducatives et récréatives. Toutefois, ces activités doivent être adaptées à leurs capacités et ne doivent pas interférer avec leur vie scolaire.
Pour conclure…
Nous assistons dans certains domaines à des prises d’initiatives intéressantes et novatrices en matière de gestion des bénévoles et responsables d’associations (micro-bénévolat, télé-bénévolat, bénévolat ponctuel, mécénat de compétence).
De nouvelles formes de bénévolat et de coopération avec la gouvernance apparaissent. Leurs mises en œuvre mixent pour une plus grande efficacité les différentes composantes actives qui sont au service de l’association (dirigeants, salariés, bénévoles, bénévolat de compétence, etc.). Cette évolution est, certes, louable et bénéfique. Elle ne peut qu’être encouragée. Encore faut-il en préserver les contours juridiques et réglementaires.
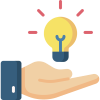
Auteur(s) :

Philippe Guay
Expert-comptable, commissaire aux comptes, spécialisé ESS
Philippe est un expert-comptable et commissaire aux comptes qui a accompagné pendant de nombreuses années de multiples associations, fonds et fondations.